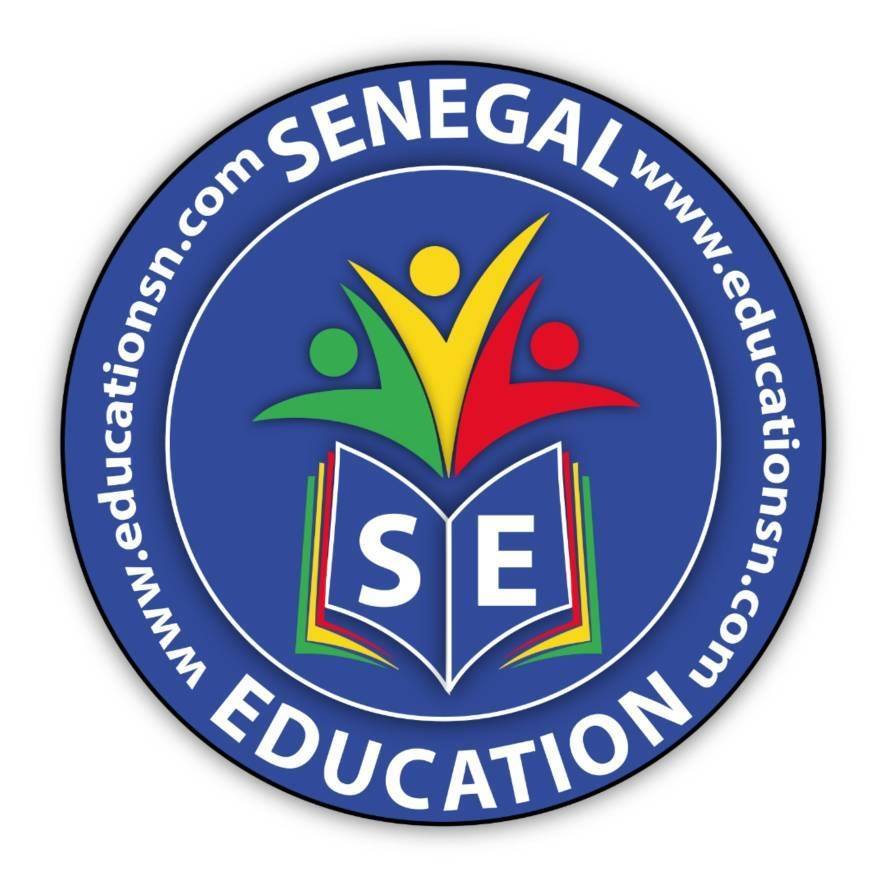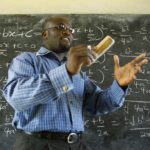« 𝗟’É𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥” 𝗗’𝗔𝗟𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗖𝗔𝗠𝗨𝗦
« L’Étranger », premier roman d’Albert Camus, fut publié en 1942. Cette œuvre, qui se dresse comme un monument de la pensée humaine, s’inscrit dans ce que l’auteur désignera plus tard sous le nom de « cycle de l’absurde ». Ainsi, à travers ces pages, l’on découvre les fondements d’une philosophie nouvelle, où l’absurde, cette irréductible contradiction entre l’homme et l’univers, s’érige en loi souveraine. Ce cycle, qui s’étend au-delà du simple roman, englobe également l’essai « Le Mythe de Sisyphe », où Camus explore l’inlassable lutte de l’homme face à l’absurde, ainsi que les pièces de théâtre « Caligula” et “Le Malentendu », où le drame de l’existence humaine se joue dans toute sa tragique beauté.
1- 𝗥é𝘀𝘂𝗺é 𝗱𝘂 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻
Cette galette littéraire relate l’histoire de Meursault, un homme solitaire et indifférent, qui vit à Alger. Le roman commence avec l’annonce de la mort de sa mère. Meursault réagit à cet événement avec une étonnante froideur, ne montrant ni tristesse, ni émotion particulière. Après les funérailles, il reprend sa routine quotidienne, entamant une relation amoureuse avec Marie, une collègue de travail, et passant du temps avec des connaissances comme Raymond, un voisin qui le mêle à des querelles.
Un jour, après un conflit avec un Arabe (qui est lié à Raymond), Meursault tue cet homme sur la plage, un acte commis apparemment sans raison claire, sous l’effet du soleil intense. L’acte semble être une conséquence de la chaleur accablante et de l’ambiance oppressante qui l’entoure.
Le roman prend ensuite un tournant avec l’arrestation de Meursault. Lors de son procès, l’accusation se concentre davantage sur son comportement lors des funérailles de sa mère que sur le meurtre lui-même, soulignant son manque d’émotion et sa rupture avec les attentes sociales. Le procès de Meursault devient ainsi un procès moral, dans lequel l’indifférence du personnage à la vie et à la mort est jugée plus sévèrement que son acte de meurtre.
À la fin du roman, Meursault est condamné à la peine de mort par guillotine. En attendant son exécution, dans sa cellule, il prend peu à peu conscience de l’absurdité de la vie et de l’indifférence de l’univers. Il accepte cette vérité, trouvant une forme de paix intérieure en embrassant la réalité d’un monde dépourvu de sens et indifférent aux actions humaines.
Le roman se clôt sur cette réflexion existentielle, où Meursault trouve enfin une sorte de réconciliation avec lui-même, en confrontant l’absence de signification de la vie et la certitude de sa fin imminente.
2. 𝗨𝗻𝗲 œ𝘂𝘃𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝗰œ𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗯𝘀𝘂𝗿𝗱𝗲
À l’épicentre de “L’Étranger” se trouve l’idée camusienne de l’absurde, définie comme l’écart entre les aspirations humaines au sens et l’indifférence du monde. Meursault, narrateur et protagoniste, incarne cet état d’être : il traverse la vie avec un détachement désarmant, révélant une indifférence non seulement envers les conventions sociales mais aussi envers sa propre existence.
Le roman commence par l’énigmatique phrase, « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. » Cette déclaration, à la fois neutre et dérangeante, établit immédiatement le ton de l’œuvre et introduit une tension fondamentale entre la logique sociale et la perception individuelle. Meursault ne cherche ni à expliquer ni à justifier ses actions, incarnant ainsi une posture de refus devant l’absurdité. Cependant, cette posture, bien que fidèle à la pensée de Camus, soulève des questions sur la cohérence morale du personnage, notamment dans son acte de meurtre, qui reste ambivalent et énigmatique.
3. 𝗨𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝘀o𝗰𝗶é𝘁é 𝗲𝘁 𝘀𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀
Dans sa deuxième partie, le roman bascule du récit existentiel vers une critique sociale et judiciaire. Le procès de Meursault illustre l’absurdité des institutions humaines, où l’accusation se concentre davantage sur son comportement lors des funérailles de sa mère que sur le meurtre lui-même. Camus dénonce ici l’hypocrisie d’une société qui privilégie les apparences morales sur les actes réels.
Cependant, cette critique de la justice est parfois perçue comme schématique. En exagérant l’absurdité des procédures judiciaires, l’auteur risque de simplifier des mécanismes complexes, réduisant la justice à un instrument de condamnation sociale plutôt qu’à un espace de réflexion sur la responsabilité. Ce choix, bien qu’intentionnel, peut limiter la portée réaliste de l’œuvre.
4. 𝗨𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗵é𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗿𝘃i𝗰𝗲 𝗱𝘂 𝘀𝗲𝗻𝘀
Le style narratif de Camus se distingue par sa sobriété et son dépouillement, en accord avec l’éthique de l’absurde. Les phrases courtes et factuelles traduisent la vision directe et sans artifice de Meursault, tandis que les descriptions répétées de la lumière, du soleil et de la chaleur renforcent l’idée d’un environnement hostile, presque oppressif.
Certes, cette approche stylistique s’avère une remarquable cohérence entre le fond et la forme : le style dépouillé reflète l’absence de profondeur émotionnelle du personnage, tout en soulignant la vacuité des conventions sociales. Mais elle n’est pas aux antipodes d’une certaine froideur, voire une sécheresse émotionnelle, qui pourrait limiter l’engagement du lecteur.
5. 𝗨𝗻 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗹 𝗼𝘂 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹 ?
Si “L’Étranger” est souvent salué pour son universalité, il n’échappe pas à des critiques liées à son contexte colonial. L’absence de nom et de voix du personnage de l’Arabe tué par Meursault laisse entrevoir une marginalisation des figures indigènes dans l’œuvre. Cette omission, interprétée comme un reflet de l’indifférence du protagoniste, peut également être perçue comme une manifestation inconsciente du regard colonial, où l’autre est réduit à une abstraction. Par ailleurs, l’Arabe, en tant que figure silencieuse, peut être lu comme un symbole de l’altérité face à laquelle Meursault agit sans raison apparente, renforçant ainsi le sentiment d’absurde.
6. 𝗟’𝗮𝗯𝘀𝘂𝗿𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗹𝗶𝗯é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲
L’aboutissement philosophique du roman réside dans l’acceptation par Meursault de l’absurde, qu’il accueille comme une vérité libératrice. Cette conclusion, où il contemple l’indifférence de l’univers avec sérénité, illustre l’idéal camusien d’une vie affranchie des illusions de sens. Toutefois, cette vision peut être critiquée pour son caractère individualiste, qui néglige les dimensions sociales et collectives de l’existence humaine.
En embrassant l’absurde, Meursault rejette toute responsabilité envers autrui, ce qui soulève des questions éthiques fondamentales. Peut-on réellement vivre en ignorant les liens sociaux et les implications morales de ses actions ? Cette tension entre l’idéal philosophique et la réalité humaine constitue l’un des paradoxes les plus fascinants de L’Étranger.
Somme toute, “L’Étranger” est une œuvre à la fois révolutionnaire et problématique. Par son exploration de l’absurde, Camus offre une réflexion magistrale sur l’existence humaine, tout en proposant une critique des normes sociales et des institutions. Cependant, le roman n’échappe pas à des limites, notamment dans son traitement des personnages secondaires et dans l’idéalisme parfois abstrait de sa philosophie. Cette dualité – entre force conceptuelle et fragilité contextuelle – fait de L’Étranger une œuvre inépuisable, dont la richesse continue de nourrir le débat intellectuel et littéraire.